Qu'est-ce que l'ergot des céréales et comment le prévenir ?
L’ergot des céréales, aussi appelé le “mal des ardents”, est une maladie fongique qui affecte notamment le seigle, le triticale et le blé tendre. A forte pression, sa présence peut être très nocive pour les êtres vivants et provoquer d’importantes pertes de rendement. Découvrez à l’échelle de l’exploitation les pratiques agronomiques à adapter et les mesures préventives à adopter pour limiter son développement.
Qu’est-ce que l’ergot des céréales ?
Qu’est-ce que le champignon Claviceps purpurea ?
Claviceps purpurea est le champignon responsable de l’ergot des céréales. C’est un champignon (ascomycète) qui produit des sclérotes noirs ou violacés au niveau des épis des graminées et qui présente des alcaloïdes, des substances organiques très toxiques pour les êtres vivants. Principalement présent dans les régions tempérées, il affecte les espèces les plus sensibles notamment le seigle, le triticale et le blé tendre. Le risque de contamination est élevé lorsque les conditions sont humides, notamment lors de la floraison. L’ergot ne compromet pas directement le rendement des cultures, mais présente une menace importante par la production d’alcaloïdes.
Le cycle de vie de l’ergot des céréales
Le cycle de Claviceps purpurea suit 3 phases : la forme hivernante, la phase primaire et la phase secondaire.
Période hivernale :
Pendant cette période, le champignon se développe sous forme de sclérotes puis reste en dormance durant l’hiver. Ces conditions climatiques favorisent la germination et leur permettent d’arriver à maturité.
Phase primaire :
Au printemps, les sclérotes commencent à germer et produisent un stroma pédicellé contenant des périthèces qui renferment des asques. Ces asques libèrent des ascospores qui sont disséminées par le vent ou par l’intermédiaire de vecteurs. Lorsqu’une ascospore est en contact avec une fleur de la plante hôte, celle-ci pénètre et commence à se développer.
Phase secondaire :
Au bout de quelques jours, le champignon produit des conidies qui se développent sous forme de miellat sur les tissus infectés attirant les insectes pollinisateurs et propagent les conidies vers d’autres fleurs saines. Progressivement, l’ovaire infecté cesse de produire des graines et se transforme en sclérote. Ce cycle de maturation s'effectue en même temps que les grains sains. Ces sclérotes sont récoltés ou tomberont au sol pour hiverner et recommencer le cycle.

Repérer l’ergot dans vos parcelles : signes et périodes à risque
L’ergot dans les champs est identifiable à maturité. Il se caractérise par l’apparition d’une masse blanchâtre puis par des sclérotes noirs ou violacés, allongée sur les épis. Son développement peut être bien visible lorsqu’il dépasse nettement de l’épi mais ce n’est pas toujours le cas, ce qui rend parfois son identification complexe. On peut parfois observer un suintement de miellat collant avant l’apparition des sclérotes pendant la floraison. L’ergot présente une taille et une forme similaire à celles des grains sains, mais se distingue par sa couleur noir violacée.

Quels sont les risques liés à l’ergot ?
Risques pour la santé humaine et animal
Les alcaloïdes produits par l’ergot comme l’ergovaline et l’ergotamine, représentent un réel danger sanitaire. Après ingestion, ces mycotoxines peuvent provoquer des troubles digestifs, affecter le système nerveux et entraîner une vasoconstriction, réduisant la circulation sanguine. Afin de limiter les risques et garantir la sécurité alimentaire, des seuils réglementaires stricts encadrent la présence d’ergot dans les cultures céréalières.
Conséquences économiques pour les exploitations
Depuis que le seuil réglementaire de l’ergot a été abaissé à 0,2 g/kg en janvier 2022, les conséquences pour les céréaliers sont de plus en plus notables.
La présence d’ergot dans les lots de céréales peut avoir des conséquences économiques majeures pour les exploitations agricoles.
En effet, en présence d’ergot dans un lot, celui-ci est susceptible d’être refusé ou déclassé, notamment s’il dépasse les seuils réglementaires en alcaloïdes d’ergot. Par ailleurs, le tri mécanique et les traitements peuvent induire des coûts élevés. Ces charges ne sont pas toujours compensées par une revalorisation du produit final, ce qui fragilise la rentabilité globale de l’exploitation.
Pour en savoir plus, consultez l’article sur les Nouvelle reglementation ergot 2022
Comment prévenir l’ergot dans vos cultures ?
Adapter l’implantation pour limiter le risque dès le départ
Pour prévenir et limiter le développement de l’ergot, il est conseillé d’effectuer des rotations de culture en alternant les céréales à paille avec d’autres cultures, d’opter pour des variétés moins sensibles, d’éviter les semis précoces et trop denses sur sols humides notamment lors de la floraison. Enfin, il est essentiel d’ajuster la densité et la profondeur du semis pour réduire les sources de contamination et favoriser une levée homogène.
Pour limiter la présence d’autres graminées comme le ray-grass ou le bromus, certains agriculteurs fauchent les bords de champs ou mettent en place des espaces de transition entre les champs agricoles et les plans d’eau (zones tampons).
Surveillance et interventions en cours de culture : les clés d’une détection précoce
L’ergot des céréales est un parasite des graminées, qu’il s’agisse de plantes cultivées (comme le seigle, le blé ou le triticale) ou d’adventices (telles que le vulpin ou le ray-grass). Ces mauvaises herbes jouent ainsi un rôle de réservoir pour le pathogène et peuvent, si elles sont mal gérées dans la parcelle ou en bordure de champ, favoriser la propagation du champignon vers la culture de céréales en floraison. Ainsi, une gestion rigoureuse du désherbage à l’automne constitue un moyen de lutte essentiel contre ce pathogène.
Pour mieux comprendre comment limiter le risque d’ergot dans vos céréales, découvrez notre article qui explique l’intérêt du désherbage d’automne dans la lutte contre l’ergot ainsi qu’un témoignage terrain.
Certaines conditions climatiques comme les périodes pluvieuses et hivernales sont particulièrement propices à la prolifération de l’ergot. Pour limiter ces risques plusieurs actions sont mises en place :
- Pendant la floraison, les agriculteurs contrôlent régulièrement les parcelles pour détecter précocement l’apparition de sclérotes noirs/violacés ou de miellat, notamment sur seigle ou triticale.
- En cas d'apparition d’ergot, les agriculteurs peuvent évaluer le niveau d’inoculum selon l’historique parcellaire, la gestion du sol et la présence d’ergot dans les parcelles.
Tri, nettoyage et gestion des résidus post récolte
En raison de la règlementation stricte et des normes de qualité, les agriculteurs privilégient la lutte préventive. La présence d’ergot suffit à rendre impropre à la vente. Même si plusieurs techniques de tri et de nettoyage mécanique permettent d’éliminer les sclérotes, cela oblige certains organismes à trier mécaniquement les lots contaminés. Ces méthodes sont performantes, mais restent coûteuses et demandent du temps.
L’ergot des céréales, un sujet d’étude pour ADAMA depuis plus de 10 ans
Depuis 2014, ADAMA travaille activement sur le sujet de l’ergot des céréales. Notre étude"Présence et perception de l’ergot chez les céréaliers français et impact des pratiques de désherbage sur ce pathogène" menée en 2015 en collaboration avec ARVALIS auprès de plus de 300 agriculteurs a révélé que l’ergot constituait une préoccupation majeure pour les producteurs de céréales, anticipant ainsi l’importance croissante de ce pathogène pour la filière céréalière ; afin d’identifier le programme de lutte le plus performant contre le pathogène, Adama a également mis en place un protocole expérimental innovant. Ce protocole a d’ailleurs fait l’objet d’une étude publiée en 2013 dans Phytoma : des adventices ont été semées sur les parcelles, à la fois dans des situations contaminées par l’ergot et dans des situations saines. Cette expérimentation a été conduite sur trois campagnes consécutives. Les résultats obtenus sont particulièrement convaincants :
• Les herbicides se révèlent efficaces pour limiter les contaminations par l’ergot dans les récoltes, tant sur la présence de sclérotes que sur la teneur en alcaloïdes.
• Seul un programme efficace en 2 applications permet d’éviter le risque de déclassement des lots et les coûts supplémentaires liés au tri de la récolte. Les nombreuses communications et formations qui en ont découlé ont ainsi contribué à sensibiliser la profession aux enjeux agronomiques et sanitaires de l’ergot.
Pour approfondir les stratégies de lutte et mieux comprendre les enjeux liés à l’ergot, vous pouvez consulter l’article Phytoma.
Pour conclure, il est essentiel d'adopter et maîtriser les bonnes pratiques agronomiques lors de l’itinéraire cultural. Par une approche préventive, les agriculteurs peuvent efficacement limiter la contamination des lots et assurer la sécurité sanitaire des filières. En cas de forte pression lorsque la gestion est trop difficile, les mesures curatives sont nécessaires. Un suivi régulier des parcelles en amont est donc indispensable.
Découvrez nos solutions de désherbage
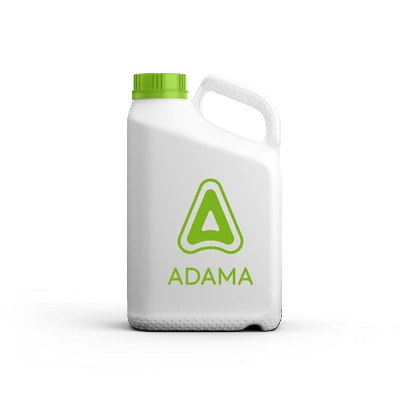
Les derniers articles
Sécurisez la production avec ExelGrow® d'ADAMA
Lire l'articleExelGrow® : le biostimulant idéal pour booster vos céréales
Lire l'article7 conseils pour réussir le semis de la betterave sucrière
Lire l'articleRestons en contact
Abonnez-vous pour recevoir les dernières publications de l'équipe ADAMA.


